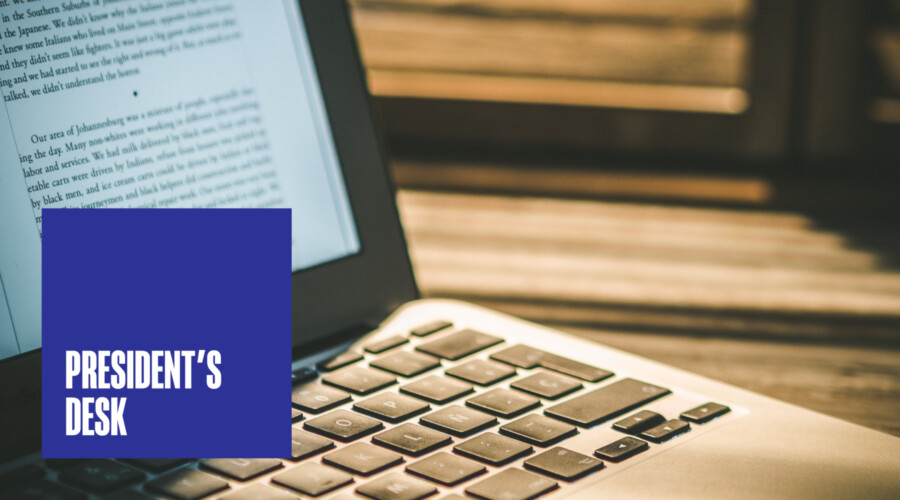Nous vivons un moment de fatigue morale. On serait pardonné si la première pensée de la journée était celle de Sisyphe, l'anti-héros de la mythologie grecque condamné à faire rouler un rocher jusqu'en haut d'une montagne pour le voir redescendre à jamais.
Des principes longtemps considérés comme sacrés - l'humanitarisme, la coopération internationale et la démocratie - sont remis en question et carrément rejetés. Et pour ceux qui ont consacré leur vie à ces principes, l'état du monde actuel suscite des sentiments de désespoir, voire de nihilisme.
Ces derniers mois, plus d'un ami ou collègue m'a posé la question suivante : " Est-il vraiment important que je prête attention aux informations ou que je les ignore complètement ?
Dans son livre Catastrophe EthicsTravis Rieder saisit ce moment et enfonce le clou éthique en écrivant : "Beaucoup d'entre nous ressentent une responsabilité individuelle dans la résolution de problèmes collectifs de grande ampleur", mais souvent "le problème est trop grand et ma contribution est trop petite pour faire la différence".
Comme le dit une vieille prière, "Ta mer est si grande, et mon bateau est si petit".
Ce moment d'épuisement moral est aggravé par des normes de pureté excessivement élevées et par la pensée à somme nulle qui prévaut dans l'ensemble de l'échiquier politique. L'esprit partisan est à son comble et les voix dissidentes sont considérées comme des ennemis de l'intérieur plutôt que comme des opposants de bonne foi. La parole est peut-être encore libre et ouverte, mais l'anonymat rendu possible par les médias sociaux et la prolifération des chambres d'écho numériques érodent la responsabilité et engendrent l'incivilité. Il faut un réel courage et un épiderme épais pour entrer sur la place publique au service des autres.
"Il faut du courage et une bonne dose d'humilité pour entrer sur la place publique au service des autres.
Mais nous devons persévérer, même face à des lacunes inévitables. Les enjeux sont tout simplement trop importants pour être ignorés et, en outre, même s'ils peuvent sembler lointains, ils ne le sont pas vraiment. La proximité à l'ère de la mondialisation ne nous permet pas d'y échapper et l'isolationnisme est une solution séduisante, mais en fin de compte inefficace.
Nous vivons dans un monde de défis à l'échelle mondiale produits par des systèmes à l'échelle mondiale. Il n'est pas simple de relier le comportement individuel de manière significative au fonctionnement de ces vastes systèmes. Nous avons besoin d'une approche éthique qui nous aide à naviguer dans les grands arrangements mondiaux impersonnels et désespérément compliqués qui servent nos choix.
L'éthique des catastrophes apporte une contribution importante en suggérant que nous passions du devoir individuel à la responsabilité institutionnelle. "Plaider est plus important que composter", écrit Rieder avec humour. "Attaquer et blâmer les individus pour leur comportement individuel est une diversion par rapport à la responsabilité collective des institutions, qui est plus importante.
Pour Rieder, l'agence morale n'a pas disparu. En fait, il s'agit d'un moment important pour la réclamer. Que peut donc faire chacun d'entre nous dans une époque aussi fracturée ? La tentation de se retirer est compréhensible. Pourtant, se retirer parce que nos actions semblent insuffisantes est une erreur, tout comme le désir de se laver les mains des choses que nous détestons.
Une étude récente du Yale Program on Climate Change Communication suggère que parmi les personnes angoissées par l'avenir de la planète, un plus grand nombre d'entre elles s'impliquent plutôt que de se désintéresser du sujet. Anthony Leiserowitz, coauteur de l'étude, écrit : "Certains ont supposé que les personnes souffrant d'anxiété liée au climat ou à l'environnement étaient paralysées par leurs craintes concernant le changement climatique, mais nous avons constaté le contraire. La plupart des personnes souffrant d'anxiété liée au climat ne se cachent pas sous les couvertures".
Si l'humeur suit l'action, il est préférable d'être proactif plutôt que réactif, d'établir son propre agenda sur les questions qui nous tiennent le plus à cœur, plutôt que de se laisser porter par les catastrophes quotidiennes d'un fil d'actualité. C'est le premier pas - délibéré et volontaire - qui compte le plus.
Il ne m'appartient pas de prescrire un programme éthique pour les autres, mais au Carnegie Council, nous sommes un espace civique où des individus de tous horizons peuvent se connecter pour travailler à un avenir fondé sur les principes de la coopération internationale, de la démocratie et de l'humanitarisme. Si ces principes peuvent sembler des platitudes, il suffit de lire les nouvelles d'aujourd'hui pour comprendre que chacun d'entre eux court le risque très réel de disparaître en tant que valeurs fondamentales de la vie publique.
Pour beaucoup, ce moment ressemble à un carrefour moral dans nos vies personnelles et professionnelles.
Y aura-t-il de nouveaux accords internationaux sur les défis mondiaux tels que le contrôle des armes nucléaires, l'intelligence artificielle et le climat ? La démocratie illibérale prospérera-t-elle ou s'estompera-t-elle ? Le monde adoptera-t-il ou rejettera-t-il l'aide humanitaire ?
Au risque de paraître trop optimiste, l'apparition de l'épuisement dans l'air du temps peut être le premier signe que quelque chose de nouveau se prépare et est prêt à être trouvé. Le contraire de l'épuisement est la résilience. Comme toute propriété naturelle, les deux existent en tandem, l'une nourrissant l'autre.
Alors qu'il réfléchissait au défi de l'épuisement moral, Albert Camus a conclu : "Il faut imaginer Sisyphe heureux".
Camus avait raison. Nous pouvons tirer satisfaction et sens du fait de faire notre part, avec les autres, et de laisser tomber le reste. Il y a quelque chose d'éclairant et d'habilitant dans le fait de savoir et d'accepter que le rocher revient toujours en arrière et que nous recommençons.
C'est notre pierre et c'est notre histoire. Le plus important est de se l'approprier, de lui donner un sens et de continuer à avancer.